Le PLU, ou Plan Local d’Urbanisme, regroupe les documents qui encadrent le développement urbain d’une commune. Projet d’aménagement du territoire, règles de construction, préservation de l’environnement, que réglemente-t-il exactement ? Que contient-il ? Comment le consulter ?
Plan Local d’Urbanisme : définition
Suite à la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a succédé au Plan d’Occupation des Sols (POS) qui fixait les règles d’urbanisme depuis 1967.
Le Plan Local d’Urbanisme est, depuis, l’outil principal d’aménagement du territoire à l’échelle d’une commune ou d’un groupement de communes. Il définit les grandes orientations du projet global d’aménagement de la commune dans le respect du développement durable.
Le règlement du PLU est opposable à toute personne publique ou privée (administration, particulier, promoteur) souhaitant réaliser des travaux de construction, de réhabilitation ou de modification d’un bâtiment existant.
A quoi sert le PLU ?
L’enjeu principal lors de la rédaction d’un PLU est de réussir à apporter une réponse aux besoins de la population en matière de logement, de déplacement et d’infrastructures tout en préservant les espaces naturels. Rendre possible l’expansion des villes sans en dégrader l’environnement, le patrimoine ni l’architecture, tel est l’objectif du PLU.
Trois grands objectifs sont poursuivis : planifier, réglementer et protéger.
- Planifier la ville consiste à présenter les grandes orientations d’aménagement souhaitées par les élus et les moyens pour atteindre ces objectifs. L’arrivée d’un tramway par exemple aura une incidence sur le développement urbain à ses abords. Le PLU accompagne ces évolutions de la ville : élargissement de voirie, orientations d’aménagement, création d’équipements,…
- Règlementer le développement de la ville, c’est définir les règles qui s’appliquent à chaque parcelle afin de mettre en œuvre les objectifs politiques choisis : densification de certains secteurs, préservation de quartiers de centres villes anciens, etc. Chaque parcelle se voit appliquer des règles de constructibilité strictes : hauteur, emprise au sol, alignement, recul, etc.
- Enfin protéger dans le PLU cela signifie identifier les éléments de patrimoine jugés remarquables et qui méritent d’être mis en valeur : espaces verts protégés, bâtiments remarquables, arbres à conserver.
Pour cela, le Plan Local d’Urbanisme découpe les communes en différentes zones. Les règles d’aménagement et de construction applicables à un terrain donné sont différentes selon la zone dans laquelle il se trouve.
Qui élabore le PLU ?
L’élaboration d’un PLU est un processus long qui prend souvent entre un an et demi et deux ans. Elle est à l’initiative des élus de la majorité et engagée par délibération du conseil municipal. Certains PLU sont établis à l’échelle de plusieurs communes. On les appelle alors PLUI pour Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Ce délai d’élaboration s’explique par la réalisation d’études approfondies de la commune mais également par les procédures. En effet, la consultation de nombreux de services de contrôle de l’Etat ou organismes locaux est obligatoire. Ainsi la Préfecture et ses services, la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) ou encore l’Architecte des Bâtiments de France émettent un avis sur le projet du PLU.
Enfin, les réformes de 2016 renforcent les obligations de consultation du public par des démarches de concertation ambitieuses. La population est associée et consultée régulièrement pour donner son avis sur les orientations et les mises en œuvre du PLU. Tous les citoyens peuvent alors contester les choix retenus à chaque étape de la consultation publique. L’ensemble des avis écrits sont pris en compte par le commissaire enquêteur dans ses rapports d’enquête publique. La collectivité devra y répondre point par point pour justifier ses choix.
Que contient un PLU ?
Un Plan Local d’Urbanisme contient plusieurs éléments :
- Un rapport de présentation : ce document détaille les raisons des choix fait pour l’élaboration du PLU. Il précise l’état initial de l’environnement ainsi que les incidences prévisibles des décisions prises. Différentes analyses et diagnostics viennent appuyer les explications.
- Un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) : véritable clé de voûte du plan local d’urbanisme, le PADD décrit les principales orientations de la commune en matière d’aménagement du territoire.
- Un règlement qui contient un plan de zonage ainsi que les règles à appliquer en matière de construction et d’urbanisation pour chaque zone. Il s’agit du document incontournable pour déterminer la constructibilité d’un terrain.
- Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : les OAP déterminent les règles d’aménagement ou de réhabilitation propres à certains secteurs ou quartiers de la commune jugés comme sensibles ou prioritaires par les élus et les services.
- Des annexes : ce sont les documents nécessaires à la bonne compréhension du PLU.
Les différentes zones définies par le PLU
Le plan de zonage du PLU divise le territoire communal ou intercommunal en quatre types de zones :
- Zone U : les zones urbaines correspondent aux secteurs de la ville déjà urbanisés. Elles se déclinent selon le type de construction admises : logement, l’hôtellerie, commerces, services, bureaux, activités artisanales ou industrielles, etc. Elles regroupent ainsi différentes dénominations comme les zones UA, UB, UC, UD, UE, UH, UP,… selon les PLU.
- Zone AU : les zones à urbaniser sont, le plus souvent, des secteurs naturels qui seron urbanisés à court ou moyen terme. Ainsi, la constructibilité de ces zones est souvent faible et en attente d’une modification du PLU par la collectivité. La ville cherche à maitriser le développement de ces zones identifiées comme stratégiques.
- Zone A : les zones A visent un usage exclusivement agricole. Ces zones ne sont pas constructibles. Les seules constructions autorisées peuvent être des hangars, des granges ou, exceptionnellement, des bâtiments d’utilité collective ou de service public.
- Zone N : les zones naturelles ou forestières sont protégées. Elles ne sont pas constructibles, mais peuvent accueillir certaines installations qui ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
On note que dans certaines communes , il n’y a pas de PLU. Dans ce cas, c’est le RNU (Règlement National d’Urbanisme) qui régit l’aménagement du territoire local. Il est alors possible de consulter la carte communale pour déterminer si un terrain est constructible ou non.
Quelle différence entre une révision et une modification du PLU ?
Une collectivité modifie régulièrement son Plan Local d’Urbanisme afin d’ajuster dans le temps ses règles et permettre la réalisation de projets. En effet, le PLU n’est pas un document figé. La collectivité peut y apporter des modifications, mais pour cela elle doit suivre un démarche très encadrée.
Une ville peut apporter des adaptations à son plan de zonage ou au règlement d’une zone de son PLU si celles-ci sont compatibles avec le projet politique annoncé dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), pièce centrale du PLU.
Ce processus de modification du PLU dure environ 6 mois. Le conseil municipal initie le processus par délibération. Une enquête publique informant la population et lui permettant de donner son avis conclue la procédure. Ainsi, là encore, les citoyens pourront contester ces modifications et la collectivité devra motiver ses choix.
Si la ville souhaite apporter des évolutions en profondeur, elle engage alors une révision du Plan Local d’Urbanisme, c’est-à-dire une refonte complète. En effet, une collectivité entreprend l’élaboration d’un nouveau document d’urbanisme généralement tous les 6 à 10 ans en raison des cycles politiques et de l’évolution du contexte communal.
Comment consulter un PLU ?
Tout PLU est consultable directement en mairie. Dans les grandes villes, il est parfois préférable de prendre RDV par téléphone avant de se déplacer.
La plupart du temps, vous pouvez consulter le PLU d’une commune en ligne sur le site officiel de la mairie concernée. Vous pourrez y télécharger toutes les pièces composant le document d’urbanisme.
Le permis de construire et le Plan Local d’Urbanisme
Un permis de construire est une autorisation administrative qui doit respecter strictement toutes les règles établies par le Plan Local d’Urbanisme.
Avant de déposer une demande de permis de construire, il est donc primordial de consulter le PLU de la commune. En effet, il faut de s’assurer de respecter le règlement local : forme et couleur du bâtiment, implantation par rapport à la route et aux voisins, emprise au sol, hauteur de la construction, règles de stationnement, raccordement aux réseaux, aspect de la clôture, etc.
Ainsi, lorsqu’un permis de construire est déposé en mairie, les services instructeurs étudient point par point sa conformité au PLU. Selon les permis de construire, la collectivité disposent alors d’un délai de 3 à 5 mois pour donner son avis. S’il est conforme, le permis de construire est alors approuvé par la collectivité.
Si vous avez des questions sur la constructibilité de votre terrain, n’hésitez pas à solliciter nos experts ! City&You vous accompagne dans toutes vos démarches pour connaitre le potentiel de votre terrain et valoriser au mieux votre bien.




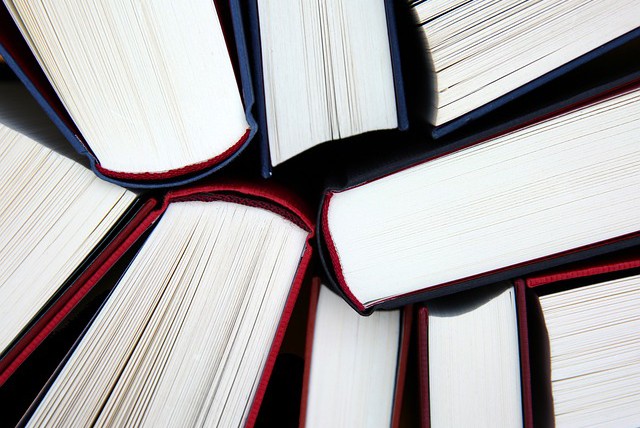



3 signes qui montrent que votre terrain intéresse les promoteurs immobiliers
Crise immobilière : est-ce le bon moment pour vendre votre terrain à un promoteur ?
Urbanisme : comprendre le RNU pour un avenir urbain durable
Tout sur le PLU bioclimatique de Paris