Parfois controversées, parfois plébiscitées, les chartes promoteur ne manquent pas d’attirer l’attention. Que sont ces documents ? Quelles informations clés y figurent ? Voici les précisions attendues.
Les propriétaires de terrains ou de biens immobiliers localisés en région parisienne sont nombreux à avoir déjà entendu parler de charte de la construction, ou charte promoteur. Mais que se cache-t-il derrière ce terme ? Ce type de document a fait son apparition il y a maintenant plusieurs années, dans l’objectif de freiner l’augmentation des prix du foncier autour de Paris et des grandes villes, et de limiter la spéculation foncière. Pour autant, il n’existe pas de consensus autour de son contenu et de ses conséquences sur les permis de construire. City&You vous apporte quelques éléments de réponse.
Qu’est-ce qu’une charte promoteur ?
Ce sont les collectivités qui édictent les chartes promoteurs de façon facultative. Elle sont destinées aux promoteurs immobiliers. Définition et fonctionnement : ce qu’il faut savoir à son propos.
Définition d’une charte promoteur
On retrouve la charte promoteur sous de nombreux noms différents : charte de la construction, charte partenariale, charte anti-spéculative, charte de développement durable, charte qualité des constructions neuves, etc. Sa vocation ? Régir les projets de construction neufs des promoteurs immobiliers via l’encadrement des prix, mais pas seulement. Type de projet, superficie des logements, matériaux utilisés… tout peut y passer ! Les mairies sont libres de définir les règles, les bonnes pratiques et les objectifs qu’elles souhaitent au sein de leur charte promoteur.
Que dit la loi ?
En 2018, le cabinet Inovefa précisait ceci : « Il n’y a pas deux chartes ou deux dispositifs qui se ressemblent, chaque commune ou communauté de commune édicte ses propres règles ». Si une telle liberté est possible, c’est parce que la loi n’encadre pas la notion de charte promoteur. En effet, elle ne fait pas partie des documents d’urbanisme réglementaires tels que le PLU. Une commune ne peut donc pas l’imposer à un promoteur immobilier. Cependant, dans les faits, les promoteurs y adhèrent généralement pour voir leur demande de permis de construire obtenir une suite favorable.
Les chartes promoteurs, toute une histoire
Depuis leur première apparition jusqu’à aujourd’hui, l’histoire des chartes promoteurs est mouvementée. Retour sur cette chronologie.
De débuts contestés…
C’est en 2016 que les chartes de la construction ont réellement commencé à faire parler d’elles. En très large majorité, ce sont les collectivités publiques d’Île-de-France qui ont décidé de rédiger ces dossiers. Confrontées à un boom des prix de l’immobilier, certaines mairies ont voulu réglementer les tarifs pratiqués sur leurs communes. Ce document a suscité l’émoi tant des promoteurs immobiliers eux-mêmes, premiers concernés, que de l’Etat français, tous craignant un rapport de force déséquilibré, des difficultés supplémentaires dans l’obtention des permis de construire et des freins au lancement de nouveaux projets. Jean-François Carenco, préfet de l’Île-de-France durant cette période, parlait alors d’« entraves à la construction ».
…à une situation normalisée
Heureusement, depuis 2016, les positions ont évolué. Les craintes ont laissé place à l’adaptation, et les promoteurs coopèrent volontiers avec les mairies concernées. De quoi garantir la bonne marche des opérations immobilières. Frédéric Cartier, directeur immobilier chez Eiffage Immobilier Île-de-France, témoignait en ce sens : selon lui, les chartes promoteur permettraient d’« imposer des règles claires à tout le monde », mais aussi de « nous améliorer sur la qualité des matériaux, la durabilité et la performance énergétique de nos logements ». Sans compter les éventuels avantages financiers sur les prix du foncier à l’achat !
En 2018, une étude du cabinet Inovefa a recensé pas moins de 50 chartes partenariales. Toutes comportent des règles et des conséquences différentes pour les promoteurs immobiliers. On retrouvera notamment les villes de Paris, Fontenay-sous-Bois, Champigny-sur-Marne, Bagneux, Malakoff, Puteaux, Montreuil, et bien d’autres encore. Elles se situent pour l’essentiel dans l’agglomération parisienne, comme l’indique le cabinet Inovefa : « A quelques rares exceptions, ces dispositifs sont concentrés dans la périphérie proche de Paris, principalement à l’Est et au Nord, dans des communes avec des habitants aux revenus modestes et une forte appétence pour l’accession à la propriété ». Elles concernent toutefois d’autres grandes villes , par exemple les métropoles de Lyon, ou de Bordeaux.
Quel est le contenu d’une charte constructeur ?
Puisqu’elles ne répondent pas à des obligations légales, les chartes de la construction peuvent inclure de nombreuses contraintes. Tour d’horizon de ce qui se fait le plus souvent.
Le prix de vente des logements
Les communes qui choisissent de créer une charte promoteur sont celles où on parle de tension du marché de l’immobilier. Cela peut entraîner une pénurie de logements et donc une spéculation foncière importante. La charte de la construction vise à rééquilibrer la situation. Pour cela, elle peut définir :
- Un prix maximum pour l’achat des terrains. La charte peut le coupler avec une décote sur le prix du foncier vendu par la commune ;
- Un prix maximum pour la revente des logements.
Exemple : La charte promoteur de la ville de Bagneux de 2016 encadre les prix de vente maximum de la façon suivante :
- 4 450 € HT/m² sur le site des Mathurins et 500 mètres autour des gares ;
- 4 300 € HT/m² pour le secteur « ville ordinaire » ;
- 3 400 € HT/m² pour l’accession sociale ;
- 3 520 € HT/m² pour 10 % des logements dans le cadre de projets de plus de 30 logements ou de plus de 2 000 m².
La surface prise en compte est celle des logements et des parkings associés. Par ailleurs, la charte précise qu’une tolérance de 30 % sur le prix au mètre carré est possible. Une mise à jour des tarifs aura lieu tous les 3 à 5 ans selon l’évolution du marché de l’immobilier à Bagneux.
Par ailleurs, plusieurs communes françaises demandent aux promoteurs de leur présenter les prix de vente des biens à construire avant toute délivrance d’un permis de construire. Certaines villes vont encore plus loin. Ainsi à Paris, face à la flambée des prix de l’immobilier, les promoteurs signataires de la charte partenariale doivent respecter un prix moyen. À défaut, ils risquent des sanctions financières : « une clause de pénalité financière sera prévue dans l’acte si le prix moyen de vente ne respecte pas le plafond fixé lors de la consultation ».
Le projet de construction
Lotissements de maisons individuelles ou lots d’appartements en résidences, tous les projets de construction pour lesquels le promoteur signe une charte partenariale peuvent supporter des contraintes globales. C’est par exemple le cas du « droit au soleil, au calme et à la vue » précisé dans la charte de la métropole de Bordeaux. Un principe plutôt vague, qui vise à réduire le risque de recours des tiers et du voisinage lors de la purge des droits du permis de construire. Second exemple : une charte de la construction peut demander à choisir les entreprises en charge de la maîtrise d’œuvre en lieu et place du promoteur.
L’accession à la propriété
Plusieurs chartes de la construction mettent en avant l’accession à la propriété au sein de leur commune. À cet effet, deux leviers sont utilisés :
- Un nombre ou un pourcentage minimum de logements sociaux doivent être prévus dans tout projet immobilier afin de permettre aux personnes aux revenus faibles ou moyens de pouvoir devenir propriétaire ;
- Une pré-commercialisation est demandée en faveur des habitants de la commune afin de les favoriser.
Cette dernière contrainte est notamment utilisée par la ville de Nanterre dans sa charte des nouvelles constructions. Appelée « Commercialisation prioritaire à destination des Nanterriens », cette clause établit une liste de personnes prioritaires, à savoir les personnes « habitant ou travaillant à Nanterre depuis un an », qu’ils soient ou non primo-accédants. À cet effet, une période de pré-commercialisation spécifique d’une durée d’un mois est prévue.
Les caractéristiques des logements
Parmi les clauses d’une charte promoteur, il est courant de retrouver des règles liées aux logements en eux-mêmes. En voici quelques exemples :
- Une superficie minimale par logement ;
- Un nombre de logements selon leur type (T1, T2…) ;
- Une répartition détaillée des superficies pour chaque lot ;
- Un nombre minimal de logements traversants ;
- Etc.
La charte de la construction durable de la ville de Montreuil incite ainsi les promoteurs à privilégier les logements traversants : « Il est proposé de définir un objectif à atteindre du type pourcentage minimum de logements traversants au sein d’une opération ». De façon encore plus précise, certaines expositions sont à éviter : « Il est fortement recommandé de généraliser la double orientation pour les T3 et plus, et de proscrire la mono-orientation Nord pour les T1″.
Transfert ou vente de permis de construire, comment ça marche ?
Vous vendez un terrain ou un logement à un promoteur immobilier ? Le transfert et la vente de permis de construire sont des pratiques souvent méconnues du grand public, mais qui peuvent pourtant s’avérer utiles. Voici les explications sur ces deux opérations.
Transférer ou vendre un permis de construire : quelle différence ?
Lors de la signature d’une promesse de vente en faveur d’un promoteur immobilier, il n’est pas rare que celui-ci demande que soit incluse une clause de transfert de permis de construire. En effet, même après l’obtention du permis de construire, un promoteur peut décider ou être contraint d’abandonner son projet. Ce sera par exemple le cas s’il ne parvient pas à réunir le financement suffisant pour mener à bien l’opération, ou s’il souhaite se concentrer sur d’autres chantiers. La clause de transfert de permis de construire présente alors un avantage majeur pour le vendeur du terrain. En effet, le permis de construire ne sera pas perdu, mais pourra être récupéré par le propriétaire.
Si la loi ne régit pas le transfert de permis de construire, la jurisprudence l’admet cependant. Pour cela, il faut réunir certaines conditions :
- Le permis de construire doit être valide, c’est-à-dire accepté depuis moins de 2 ans (date de validité) ;
- Le projet de construction ne doit pas avoir commencé ;
- Le promoteur immobilier et le vendeur du terrain doivent être d’accord ;
- Les droits devront être à nouveau purgés, néanmoins seul un recours administratif pourra avoir lieu, excluant tout recours des tiers ;
- Le promoteur immobilier doit remplir 4 exemples du formulaire n° 13412*02 CERFA, puis procéder à l’envoi du dossier complet via un courrier recommandé avec accusé de réception.
Une fois le permis transféré, le vendeur du terrain pourra choisir d’utiliser lui-même le permis ou, plus simplement, le revendre à un autre promoteur immobilier. Une telle opération est intéressante pour lui : il n’aura pas à s’occuper du formalisme lié à la demande de permis de construire et pourra ainsi commencer le chantier au plus vite.
Est-il possible de transférer ou vendre un permis de construire avec une charte promoteur ?
Lors d’une demande de permis de construire, le promoteur immobilier échange avec les élus de la commune. S’il doit respecter une charte, alors le projet déposé pour le permis de construire doit être cohérent. Il peut donc le transférer au du vendeur du terrain, qui pourra alors à son tour le revendre sans contrainte.
Chez City&You, nous accompagnons les propriétaires dans la valorisation de leurs biens immobiliers. Il est impératif de connaître l’ensemble des contraintes qui s’imposent aux promoteurs et investisseurs pour déterminer le potentiel d’un bien. N’hésitez pas à contacter nos experts !




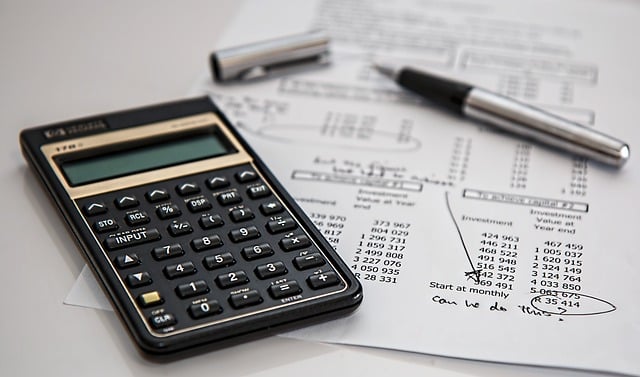

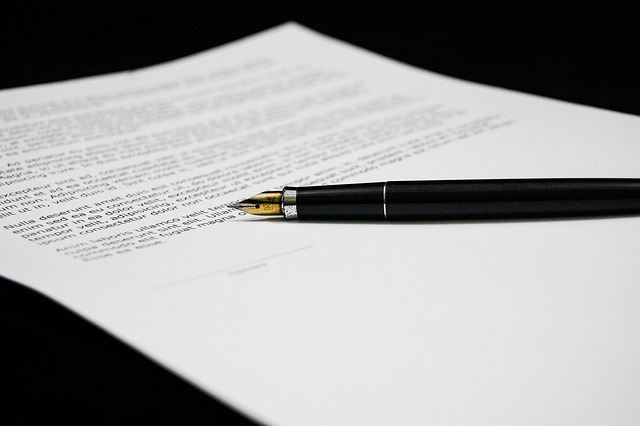

3 signes qui montrent que votre terrain intéresse les promoteurs immobiliers
Crise immobilière : est-ce le bon moment pour vendre votre terrain à un promoteur ?
Urbanisme : comprendre le RNU pour un avenir urbain durable
Tout sur le PLU bioclimatique de Paris